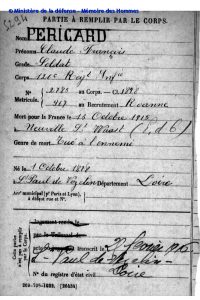Le roman de guerre de la petite veuve. Son mari, peintre en bâtiment, mort phtisique peu avant la guerre, l’a laissée seule à 28 ans avec un petit garçon. La jeune femme demeure dans une maisonnette incomplè[te]ment payée, au bout d’une rue inachevée et que barre un mur de jardin. Un soir de février 1915, son locataire du rez-de-chaussée – un marchand de journaux manchot – l’appelle : « Mme Bertrand, écoutez ce que disent là dehors ces deux soldats. Ça fait pitié. » Devant la maison, les deux passants perdus dans un épais brouillard se concertent avec l’accent chantant du Nord :
« C’est pas une rue.
– C’est pas une cour.
– Faudrait voir à retrouver votre chemin.
– Quand on coucherait sous un balcon, on serait aussi au chaud que sur la terre nue de la grange où qu’on nous a mis.
– C’est fort que dans un si grand patelin on ne trouve pas un peu de paille pour coucher des militaires.
– Bah ! on se couchera sur ma capote et on se couvrira avec la tienne… »
La petite veuve hésite : il y a un lit inoccupé dans une des deux mansardes qui constituent son logement… oui, mais qu’est-ce que le « monde » dirait ?… Et puis chacun ne secourt-il pas les soldats ? La porte est ouverte ; le locataire offre une tasse de café aux soldats ; la veuve leur propose le lit inoccupé. Ils craignent de déranger, elle insiste, ils acceptent enfin. Elle les abrite huit jours ; discrets, polis, ils confient leur histoire ; ils sont du Nord, de Caudry ; l’un a laissé là-bas sa femme et deux enfants, l’autre, nommé Denève, sa vieille mère ; celui-ci a des terres, deux maisons, huit vaches et six chevaux, et 30 000 F « au revenu ». Tous deux sont sans nouvelles des leurs. Ils partent se confondant en remercîments. Le père de famille écrit une fois, l’autre adresse trois lettres que la veuve, craignant de se compromettre, laisse sans réponse, mais dont elle admire la belle écriture et les belles phrases.
Six mois passent ; un soir de moisson, une gamine vient chercher la veuve à la ferme où elle travaillait ce jour-là. « Un soldat vous demande. » Elle croit à une farce. « Je dois souper ici, qu’il m’attende s’il veut ! » À sa porte, un soldat fait faction. C’est le persévérant Denève. Blessé, il est revenu à son dépôt ; il vient prendre des nouvelles de sa bonne hôtesse et … de ses lettres. Ses lettres ? Quelles lettres ? Sans doute, elles se sont égarées. Toujours isolé, affecté de l’invasion de sa province, le soldat demande la permission de venir quelquefois causer avec la Marguerite. De plus en plus l’on sympathise. Le Flamand n’ose pas se déclarer de vive voix. Un matin, il envoie par la poste sa demande en mariage. Le bon cœur, la gentillesse de la petite veuve l’ont touché. Il sera un père, sa mère sera une grand-mère pour le petit Jean. Il assurera 10 000 F au bambin. Le dimanche suivant, il vient comme d’ordinaire et ne souffle mot de sa demande ; mais dans la semaine, il insiste toujours par écrit. Si la Marguerite ne veut pas se remarier, il ne lui parlera plus de ses projets ; mais quelle existence l’attend ; il serait content de l’aider… À sa nouvelle visite, la Marguerite se décide à répondre. Denève peut faire un meilleur mariage. Épouser une veuve grevée d’un enfant et de dettes et plus âgée que lui de 2 ans ? Que dira sa mère. Cette pauvre veuve est bonne et vaillante ; il ne peut pas trouver mieux. Denève ne veut pas abandonner son pays ; elle ne veut pas quitter le sien. Ni vivre avec une belle-mère.
« Il y a deux maisons, on habitera l’une et la maman l’autre.
– Et puis l’on n’épouse pas un soldat en temps de guerre. Ce serait le mariage du soleil et de la lune : quand l’un se lève, l’autre se couche ; ils ne sont jamais ensemble.
– Mais après la guerre ? »
La Marguerite ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non. Et le soldat repart presque agréé. Il envoie une bague d’aluminium et sa photo en double ; une pour la petite veuve, l’autre pour sa mère, en cas de malheur. Il écrit de longues, fréquentes, éloquentes lettres auxquelles la Marguerite répond de son mieux. Un jour, la lettre du pauvre ga[r]s des régions envahies est plus triste. Il a fait une marche harassante des tranchées à l’arrivée et repose leste une soupe froide sous la pluie glaciale dans la boue. « Si les mères voyaient les souffrances de leurs fils, elles en mouraient de chagrin. » Ensuite, c’est le silence. Qu’est devenu le prétendu. Un camarade annonce enfin sa mort et dit approximativement le lieu de sa sépulture. La Marguerite se sent un peu plus veuve et attend la fin de la guerre pour envoyer à l’autre pauvre femme – si la domination boche et l’angoisse ne l’ont pas tuée – elle [illisible] la photo de son fils mort et pour lui parler des derniers temps du jeune homme. Si j’étais la mère, j’aurais une fille et un petit-fils : la Marguerite et son blondinet Jean.


 ravitaillement pendant le Gouvernement de Painlevé de du 12 septembre au 16 novembre 1917
ravitaillement pendant le Gouvernement de Painlevé de du 12 septembre au 16 novembre 1917