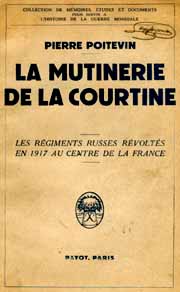La blonde distinguée Alice C., qui semble sous son g[ran]d chapeau noir d’un modèle digne d’un Reynolds, m’est arrivée les mains pleines d’ampoules, trainant un sac de pommes de terre ; un champ fut semé, sarclé, buté, récolté par sa mère et elle.
Visite de ma chère Louise. Son frère, à l’hôpital, de nouveau malade par suite de l’absorption de gaz asphyxiant ; son père, le pouce de la main droite à moitié coupé par une scie mécanique, métayer et domestique à la guerre ; elle fait les travaux des champs et a conduit hier la moissonneuse, travail très dur parce que les blés sont versés ; le triste état des siens, les maux publics, ses angoisses particuliers pour l’avenir et l’énervement d’un labeur accablant, lui donnent une envie constante de pleurer. J’ai caressé affectueusement ses mains naguère si blanches, maintenant brunies et durcies. « Ce sont de bonnes guerrières, vos mains, elles luttent énergiquement ; elles n’avaient qu’une beauté physique, elles ont une beauté morale. Pleurez si cela vous détend, mais sans amertume ! Vous faites si pleinement votre devoir ! À votre tâche, vous joignez celle des hommes empêchés de votre famille. Pour cela, je vous aime mieux. »
Les défenseurs des Allemands achètent un[e] propriété de 50 000 F, vaste demeure et jardin. Serait-ce avec des billets suisses ? Ils m’engagent à passer une journée dans leur nouveau domaine. Je me promets de n’y pas mettre les pieds. Est-ce même bien pour leur compte qu’ils l’ont acheté ? L’ennemi n’a pas renoncé à s’implanter pacifiquement chez nous, même en temps de guerre.
À L’hôpital : récits d’un otage civil rapatrié, un pauvre vieux de 70 ans. Les Barbares ont tout pris chez lui, jusqu’aux anneaux de mariage des femmes.
Témoignage d’un grand blessé rapatrié.
Les gradés boches se réunissaient trois ou quatre pour manger devant les prisonniers le contenu des colis venus de France. Ils permettent seulement au destinataire de goûter les provisions. « Tu vois ce qu’il y a, note-le pour en accuser réception dans ta prochaine lettre. À ta santé ! »
À L’hôpital : récits d’un otage civil rapatrié, un pauvre vieux de 70 ans. Les Barbares ont tout pris chez lui, jusqu’aux anneaux de mariage des femmes.
Témoignage d’un grand blessé rapatrié.
Les gradés boches se réunissaient trois ou quatre pour manger devant les prisonniers le contenu des colis venus de France. Ils permettent seulement au destinataire de goûter les provisions. « Tu vois ce qu’il y a, note-le pour en accuser réception dans ta prochaine lettre. À ta santé ! »